Macrophotographie et numérisation de diapositives avec un appareil photo numérique.
I.
Macrophotographie avec un appareil photo numérique (APN)
On commencera par essayer l’appareil en position
macro pour voir si l’agrandissement est suffisant et si les déformations ne
sont pas trop importantes. Sinon, il faudra utiliser un adaptateur macro,
acheté ou bricolé. Un adaptateur macro est l’équivalent de la « bonnette »
que l’on utilisait dans le temps sur les appareils argentiques simples. C’est
une lentille grossissante placée devant l’objectif. Cela peut aller de la loupe
de lecture à un objectif d’appareil photo ou autre, en passant par des
lentilles de récupération obtenues en démontant divers instruments d’optique.
Evidemment, un doublet achromatique traité anti-reflets est préférable à la
simple loupe. Il faudra faire des essais pour déterminer le meilleur choix.
Les défauts souvent constatés sont le vignettage, le
flou à la périphérie et les déformations de l’image. La plupart du temps, il
faudra zoomer pour éviter la photo ronde ou les coins coupés, le champ de la
lentille ajoutée n’étant pas suffisant. Mais c’est un des avantages par rapport
à la position macro, qui sur de nombreux appareils, n’existe qu’en grand angle et
oblige à placer l’appareil trop près de l’objet, au détriment de l’éclairage.
(Ce qui n’est par contre pas un problème pour la reproduction des diapos).
La focale de l’accessoire macro est fonction de la
taille de l’objet à photographier. Le tableau de la figure 1 résume les essais
effectués avec deux appareils Canon Powershot qui ont l’avantage de disposer
d’une baïonnette pour fixer les accessoires
Un objectif de jumelles 10 x 50 de focale
Il est important de bien aligner et centrer la
lentille additionnelle sur l’objectif et de la fixer le plus près possible, en
veillant à ne pas gêner les mouvements de l’objectif. Il faudra aussi lors des
essais déterminer la combinaison donnant le minimum de déformation. Sans
additif, la plupart des appareils ont une déformation en tonneau en grand angle
et en coussin en focale longue. Entre les deux, il y a une focale sans
déformation.
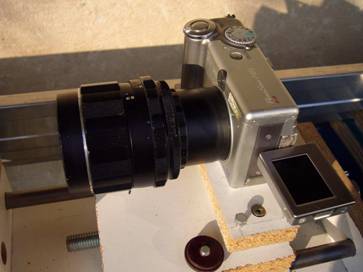
Photo
1 : A 80 avec objectif

Photo 2 : A 80 avec doublet achromatique
récupéré sur un objectif de photocopieur,

Photo
3 : A 80 avec lentille d’un oculaire de
Figure 1
|
|
|
Essais macro |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Canon A650 |
Canon A80 |
||||
|
Objectif
additionnel |
Focale |
Zoom mini |
Zoom maxi |
Remarque |
Zoom mini |
Zoom maxi |
Remarque |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loupe 15X |
16 |
|
3.5 x 5 |
qualité
faible |
|
|
|
|
Oculaire
jumelles |
20 |
|
4 x 5 |
Flou sur
les bords |
|
|
|
|
Loupe 10
X |
24 |
9 x 12 |
6 x 8 |
moins net
sur les bords |
|
|
|
|
Oculaire
doublet |
30 |
|
|
|
22 x 30 |
7 x 10 |
Photo 3 |
|
Praktica |
50 |
14 x 18 |
10 x 14 |
Sans
bague sur |
15 x 20 |
13 x 17 |
|
|
Olympus |
50 |
20 x 27 |
10 x 13 |
|
26 x 35 |
13 x 17 |
|
|
Saphir B |
50 |
|
|
Champ
trop petit |
|
|
|
|
Doublet
achromatique |
70 |
|
|
|
45 x 60 |
15 x 20 |
Photo 2 |
|
Rodenstock
agrand. |
75 |
|
14 x 18 |
Vignettage |
|
16 x 20 |
|
|
Super
Takumar |
85 |
25 x 35 |
16 x 22 |
Repro
diapo |
34 x 45 |
19 x 25 |
Repro
diapo, photo 1 |
|
Rodenstock
agrand. |
105 |
|
20 x 27 |
|
|
|
|
|
Rodenstock
agrand. |
150 |
25 x 35 |
45 x 60 |
|
|
|
|
|
Rodenstock
projo |
180 |
30 x 40 |
50 x 70 |
|
|
|
|
|
Topcon
photocop |
200 |
30 x 40 |
60 x 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sans en
macro |
|
25 x 35 |
60 x 80 |
|
41 x 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les
meilleurs choix en jaune |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II.
Reproduction de diapositives
Pour pouvoir reproduire des diapositives avec un
appareil photo numérique, il faut trois éléments :
- un appareil photo permettant la macro au format
- une source de lumière uniforme
- un support stable pour l’ensemble et en particulier
pour la diapo.
En reproduction de diapos, un APN de 4 Mpx donne un
résultat équivalent à un scanner à 1700 dpi non interpolé, ce qui est
généralement suffisant, et un 8Mpx équivaut à 2400 dpi. Mais surtout, l’APN est
beaucoup plus rapide que le scanner. On passe de 20 diapos à l’heure à près de
300 avec un bon passe vue.

1) La source de lumière
La solution la plus simple est une feuille de papier blanc placée au soleil
ou à la lumière du jour, mais une source fixe artificielle sera plus commode et
plus constante. On a le choix entre la lampe de bureau, une ampoule
fluocompacte, une ampoule à iode basse tension. Evitez les tubes fluo standard
qui papillotent. Sur le prototype, j’ai utilisé une ampoule 12 V 50 W à iode
avec un cache en alu aéré, alimentée par un transformateur.
Pour que l’éclairement soit régulier, il faudra
intercaler un verre opalin ou dépoli entre la lampe et la diapo. Une ou deux
couches de papier calque entre deux vitres pourra également faire l’affaire.
Attention à ne pas placer un verre dépoli trop près de la diapo, sinon son
grain sera visible sur la reproduction.
2) Le support.
Pour les essais, on pourra se contenter de cales en
bois, carton ou polystyrène, mais pour un usage intensif, une construction
rigide est nécessaire.
Pour la diapo, l’idéal est de récupérer un passe vue
sur un ancien projecteur. Sinon, une plaque de contreplaqué percée d’une
ouverture de
Après essais et détermination des distances entre les
éléments, on fixera la source de lumière, le passe vue et l’APN sur une planche
en sapin ou en aggloméré bien rigide en préférant des fentes plutôt que des trous pour les vis de fixation, afin
de pouvoir fignoler les réglages.
Une construction avec rails comme sur les photos
jointes n’est pas nécessaire pour une utilisation occasionnelle avec un seul
APN. En cas d’utilisation d’appareils différent, cela facilite leur adaptation.
Pour obtenir les bonnes couleurs, on commencera par
régler la balance des blancs avec le passe vue vide. Ensuite, si c’est
possible, on choisira une ouverture suffisamment faible, 8, 11 ou 16 pour avoir
de la profondeur de champ. L’automatisme fonctionne généralement bien pour le
temps de pose, en cas de difficulté, passer en manuel. Avec un support stable,
des temps de pose longs ne sont pas gênants. La diapo étant à peu près plane,
l’autofocus fonctionne bien aussi.
Avec un APN au format 4/3, on a le choix entre perdre
un peu sur la largeur de la diapo, ou recadrer ensuite les vues avec un
logiciel de traitement photo, les diapos étant au format 3/2.
On évitera aussi un éclairage d’ambiance trop
intense, pour ne pas photographier l’objectif de l’APN par réflexion sur la
diapo.
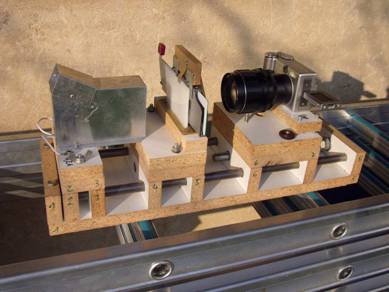
Photo 4 : vue d’ensemble

Photo 5 : vue d’ensemble
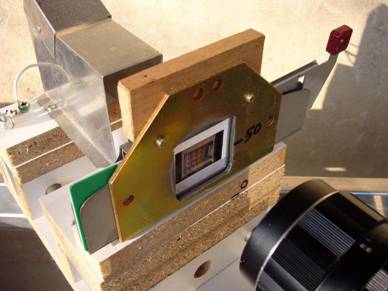
Photo 6 : gros plan sur le passe vue
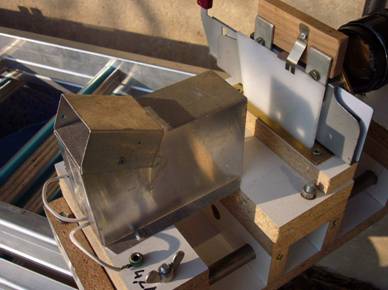
Photo 7 : la boîte à lumière et le verre opalin
devant le passe vue